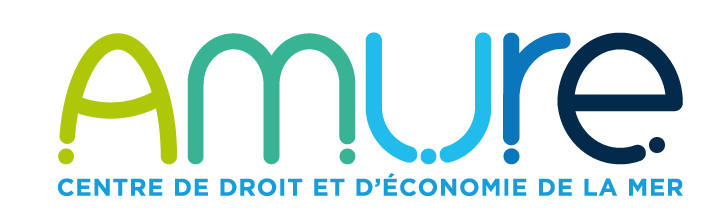Prises et emprises : chasser et cueillir les thons tropicaux à l’ère des Dispositifs de Concentration de Poissons dérivants.
Séminaire avec Manon Airaud, anthropologue
Je propose de venir présenter ma thèse d’anthropologie soutenue le 14 novembre 2024 à Montpellier, sous la direction de Pierre-Yves Le Meur (IRD – UMR SENS IRD) et Laurent Dagorn (IRD – UMR MARBEC). À cette occasion je souhaite vous exposer les perspectives de recherche imaginées aujourd’hui pour faire suite à ce travail.
Titre de la thèse : Prises et emprises : chasser et cueillir les thons tropicaux à l’ère des Dispositifs de Concentration de Poissons dérivants. Une anthropologie du métier de marin pêcheur sur les thoniers senneurs tropicaux de la pêcherie française
Résumé : Cette thèse s’intéresse aux expériences sociales et pratiques du métier de marin pêcheur sur les thoniers senneurs tropicaux. Elle s’appuie sur un travail ethnographique mené entre janvier 2019 et septembre 2021 à Abidjan, dans le Finistère et à bord d’un navire, auprès du secteur opérationnel de la pêcherie thonière tropicale à la senne française. Comment les mécanismes de standardisation et d’écologisation des processus de production se matérialisent-ils et composent-ils des expériences, qui sont vécues à l’aune de leur réinterprétation et de leur prise en charge par les marins ?
Deux fils conducteurs liés parcourent l’ensemble de la thèse. Le premier est celui de l’analyse des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) comme objet-frontière : des protagonistes mus par des intérêts hétérogènes, parfois contradictoires, sont rassemblés autour de cet instrument d’aide à la pêche sur lequel s’appuie le projet productif de cette industrie. Le second fil est contenu dans l’expression : « nous sommes passés d’un métier de chasseur à un métier de cueilleur ». L’analyse est orientée et traversée par les différents registres discursifs, cognitifs et normatifs qui éclairent le point de bascule qu’ont généré les DCPd dans les rapports entretenus par le secteur opérationnel avec les environnements maritimes hauturiers.
La thèse pose deux questions principales et transversales :
─ Quelles sont les voies empruntées pour produire du sens dans l’activité lorsque celle-ci est prise dans des rapports de subordination multiples (aux techniques, à la hiérarchie, aux objectifs de rendements maximaux, aux réglementations) ?
─ Comment les marins éprouvent-ils et sont-ils engagés dans un projet aux impératifs a priori contradictoires, à savoir celui de « remplir les cuves » et de « pêcher mieux » ?
En contrepoint aux travaux sur cette pêcherie qui portent presque exclusivement sur la ressource thonière, les DCPd sont analysés au prisme du travail des marins. L’usage des DCPd est orienté par et vers les logiques productives, et l’écologisation des aspirations et des pratiques. À l’hétéronomie progressive des marins-pêcheurs face à la technique, aux détenteurs des capitaux des entreprises pour lesquels ils travaillent et aux politiques de gestion de la pêcherie, s’ajoute une invisibilisation des tensions et des dissonances, tout comme de la parole qu’ils portent sur les environnements professionnels et écologiques dans lesquels ils exercent leur métier. Cette thèse souhaite contribuer à les rendre plus visibles.
Mardi 4 mars 2025
14h > 15h
Salle D134 IUEM
et via Zoom
lien sur demande